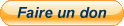L’encéphalopathie spongiforme bovine
L’encéphalopathie spongiforme bovine (la vache folle) est une infection dégénérative du système nerveux central des bovins. C'est une maladie mortelle, identique à la tremblante des ovins et des caprins (petits ruminants), causée par un agent infectieux moléculaire (une molécule est la plus petite portion d'un corps chimique qui existe à l'état libre, constituée d'atomes) d'un type particulier (ni virus, ni microbe), appelé protéine prion. Un prion est un type d’agent pathogène (susceptible de provoquer une maladie) de nature protéique qui au contraire des agents infectieux conventionnels tels que les virus, les bactéries ou encore les parasites, est exempt d’acide nucléique comme support de l’information infectieuse. Il existe deux types d'acides nucléiques : l'acide désoxyribonucléique (dit ADN) et l'acide ribonucléique (dit ARN). L'ADN est le support de l'information génétique c’est-à-dire qu’il contient le génome, tout ce qui est nécessaire à la formation des protéines.
I - Origines de l’épidémie :
On ne sait pas réellement comment est apparu l'agent pathogène (capable de provoquer des lésions et engendrer une maladie) de l'ESB mais deux hypothèses dominent.
La première est une contamination interspécifique (entre plusieurs espèces) à partir d'une maladie proche, la tremblante du mouton (premier cas en 173.. en Grande-Bretagne). Cette possibilité a été expérimentalement prouvée mais les troubles cliniques et neuropathologiques (spécialité médicale s'intéressant à la pathologie du système nerveux dans son ensemble) diffèrent dans les deux cas.
Ce constat a conduit à une seconde hypothèse qui est que la maladie serait endémique (persistance d’une maladie infectieuse au sein d’une espèce) à l'espèce bovine et très faiblement répandue avant qu'elle ne soit amplifiée au milieu des années 1980. Le cas de tremblante chez les bovins est un argument utilisé par les défenseurs de cette seconde théorie.
Avant l'apparition des cas d'ESB, les farines animales ont été très utilisées dans l'alimentation du bétail (animaux concourants à la production agricole) et d'autres animaux, car à la fois riches en énergie et en protéines, et bien digérées (transformer des aliments dans les voies digestives afin de les assimiler) par les ruminants. Elles étaient donc très utilisées chez les bovins, et plus particulièrement chez les vaches laitières. C'est la consommation par les bovins de farines animales issues de tissus calcinés (brulés) provenant de bovins ou d'ovins, comme la cervelle et la moelle épinière, et contaminés par l'agent de l’ESB qui est responsable de l'apparition de l'épidémie.
Initialement, ces farines étaient stérilisées (destruction des germes pathogènes) à hautes températures et une étape d'extraction (opération pour retirer d’une matière première un ensemble de produits qui constituent l’extrait) des graisses par solvants organiques (qui a la propriété de solubiliser les graisses ainsi que de nombreuses substances) permettaient de détruire d'éventuels prions pathogènes. Mais en 1981, les températures de stérilisation ont été abaissées et l'étape d'extraction des graisses par solvants a été éliminée. Cette simplification du protocole (ensemble des règles) visait à améliorer la rentabilité, d'une part en préservant mieux les protéines contenues dans les farines, d'autre part en diminuant les achats de solvants et d'énergie dont les coûts avaient beaucoup augmenté après les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979.
De plus un accident de manipulation de solvant dans une des principales usines anglaises de fabrication de farines animales avait entraîné un renforcement des mesures de sécurité dont le coût était élevé, ce qui a aussi encouragé cette modification des pratiques qui semble avoir causé l'épidémie. Le prion a alors pu être distribué dans les farines animales à grande échelle via les aliments du bétail, et les animaux contaminés et abattus étaient à leur tour réduits en farines, ce qui aggravait le phénomène.
Une voie de contamination (envahissement d’un organisme vivant par des micro-organismes pathogènes) mère-veau est aussi soupçonnée. Elle pourrait représenter jusqu'à 10 % des contaminations.
II - Les symptômes de l’encéphalopathie spongiforme bovine (l’ESB) :
L’ESB affecte le cerveau et la moelle épinière des bovins. Elle provoque des lésions cérébrales (modification de l’organe, du tissu sous l’influence d’un agent pathogène ou d’un traumatisme) qui se caractérisent par des altérations à allure spongieuse visibles au microscope optique, correspondant à des neurones qui se sont vacuolisés (cavité du cytoplasme des cellules rempli de liquide contenant diverses substances). Il y a une perte de neurones plus ou moins importante, et une multiplication des astrocytes qui sont des cellules du cerveau à fonction immunitaire. Les agents pathogènes s'amassent pour former des plaques amyloïdes (accumulation extracellulaire de bêta-amyloïde qui est un peptide).
Les symptômes extérieurs apparaissent généralement 4 à 5 ans après la contamination, et toujours sur des animaux de plus de 2 ans (entre 3 et 7 ans généralement). Ils se manifestent au début par une modification du comportement de l'animal, qui peut parfois donner des coups de pied, manifester une appréhension et une hypersensibilité aux stimulations externes (bruit, toucher, éblouissement) et s'isoler du reste du troupeau.
L'animal atteint voit généralement sa production laitière et son poids diminuer, alors que son appétit ne diminue pas. L'évolution peut durer d'une semaine à un an, les différentes phases de la maladie étant d'une durée variable d'un animal à un autre. Au stade ultime d'évolution, l'animal a de véritables troubles de la locomotion. Il perd fréquemment l'équilibre, sans parvenir parfois à se relever.
Du point de vue physiologique, on observe une tachycardie, qui est une accélération anormale du rythme cardiaque, et une absence de fièvre. Cependant, l'apparition de ces symptômes ne permet pas tout le temps de détecter un cas d'ESB. En effet, les troubles locomoteurs, comme la tétanie d'herbage (qui est une maladie métabolique pouvant toucher les ruminants), sont fréquents chez les bovins. Le diagnostic de la maladie est donc difficile.
Coupe histologique dans une moelle de vache atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine.
III - Farines animales :
Une farine animale est produite à partir de produits non consommables par les hommes et récoltée par la filière de l'élevage animal et de l'industrie de la pêche.
Les aliments concentrés sont conçus à partir de diverses matières premières, dont les farines animales avant la crise de la vache folle (années 90). Le principal intérêt des farines animales pour les éleveurs européens était de compenser leur large déficit en plantes oléo-protéagineuses qui sont des plantes dont les graines ou les fruits sont riches en lipides et en protéines tels que le soja, le tournesol ou le colza, qui sont indispensables pour apporter aux animaux les quantités de protéines (macromolécule hydrolysable présente dans tous les tissus de l'organisme) nécessaires à leur bon développement.
Ces plantes sont peu cultivées en Europe, qui est largement dépendante des producteurs d'Amérique du Sud et des États-Unis. Cette dépendance s'est accrue dans la seconde partie du XXe siècle du fait du développement des élevages hors-sol (élevage intensif) et des accords commerciaux mondiaux qui permettaient aux Européens de soutenir financièrement leur grain en contrepartie de l'ouverture de leurs frontières aux oléo-protéagineux étrangers.
Elles ont l'avantage d'être riches en protéines, protéines peu dégradées par les micro-organismes du rumen qui est le premier estomac des ruminants (la panse) des ruminants.
La rumination : chez certains mammifères (ruminants) c’est une action qui permet de ramener, depuis la panse, les aliments dans la bouche pour les mâcher de nouveau.
Les farines animales apportent donc des acides aminés indispensables qui sont des molécules qui, combinées entre elles, forment les protéines, également appelées amino-acides. (lysine (1) et méthionine (2)). Elles apportent également en quantité du phosphore et du calcium. Cet intérêt nutritionnel ne suffit pas à lui tout seul à justifier l'utilisation des farines animales dans l'alimentation. En effet, des solutions alternatives existent, comme notamment les tourteaux (résidu) de soja et de colza qui peuvent être tannés pour que leurs protéines ne soient pas dégradées par les micro-organismes (microbes) du rumen.
(1) (2)
IV- Le prion :
Le prion est une sialoglycoprotéine (glycoprotéine contenant de l’acide sialique) de 253 acides aminés. Les sialoglycoprotéines interviennent dans l’adhésion cellulaire (ensemble des mécanismes cellulaires et moléculaires mis en œuvre pour faire adhérer les cellules entre elles ou avec le milieu qui les entoure). C'est une forme dite résistante de cette protéine qui est responsable de la maladie. Cette forme diffère de la forme normale uniquement par sa conformation, qui la rend particulièrement hydrophobe (qui évite l’eau), ce qui explique la formation des agrégats résistants aux protéases (enzymes qui brisent les liaisons peptidiques des protéines) et l’accumulation de la protéine infectieuse dans la cellule.
La protéine modifiée pénètre dans la cellule par endocytose (mécanisme de transport de molécules vers l'intérieur de la cellule) ou par le biais du récepteur spécifique du prion normal, la protéine LRP, qui semble intervenir dans le processus puisque sa concentration augmente avec la contamination. Une fois la protéine anormale entrée dans la cellule, elle transforme les prions normaux en prions résistants. Les protéases n'étant plus capables de les détruire, ces protéines s'accumulent pour finir par provoquer la mort du neurone (cellule excitable du système nerveux), et ainsi la formation de plaques amyloïdes.
Comme le prion est une protéine, il n'a pas de métabolisme (transformer) propre et il est donc résistant à la congélation, à la dessiccation (dessécher) et à la chaleur aux températures normales de cuisson, même celles atteintes pour la pasteurisation (destruction des micro-organismes par chauffage (60-90 degrés Celsius) sans ébullition puis refroidissement brutal) et la stérilisation.
Pour être détruit, le prion doit être chauffé à une température de 133 °C pendant 20 minutes à 3 bars de pression.
Représentation de la forme normale de la protéine (à droite) et de la forme infectieuse (à gauche), le prion.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Il n'existe actuellement aucun traitement curatif contre la maladie, et elle n'a pu être enrayée que par des mesures prophylactiques, la maladie a été identifiée pour la première fois en Grande-Bretagne en 1986.
Vache atteinte de l'encéphalopathie
spongiforme bovine